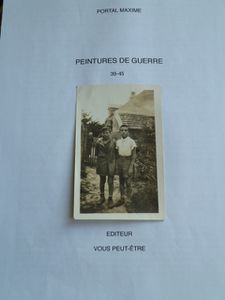Nous venions de recevoir une lettre de tonton Roger nous annonçant sa venue.
Tante Augustine dit qu’elle trouvait ça bizarre, car il venait rarement, à moins dit-elle, qu’il vienne pour accompagner Christiane.
Tante et grand-mère connaissaient les activités de notre oncle. Nous savions et Bernard aussi, puisqu’il avait aidé à sauver ses parents, qu’il s’occupait dans la résistance à faire passer en zone libre, en Espagne et en Suisse, des familles juives, des pilotes de la RAF, anglais et américains. Sa déformation physique et sa frêle santé l’empêchaient de courir les maquis les armes à la main, mais sa contribution courageuse si utile à tant de gens ne le mettait pas à l’abri des mêmes risques. Aussi nous avait-il expliqué qu’il évite de venir nous voir, car il ne voulait pas signaler notre maison ou tant d’enfants avaient trouvé refuge.
Quelques jours seulement après son courrier, il était parmi nous. Effectivement, notre petite cousine l’accompagnait. Nous fûmes tous très heureux de la revoir, elle allait vers ses sept ans, et nous la trouvâmes bien changée.
— Tu n’es quand même pas venu que pour accompagner Christiane ? Jean va arriver, il aurait pu s’en charger dit ma tante.
— Oui, bien sûr, mais je viens pour toute autre chose. Je viens chercher Maxime !
Un grand silence se fit dans la pièce ! Tout d’abord, parce que tonton Roger avait pris un ton solennel pour nous annoncer cela, puis surtout, jamais personne ne venait me réclamer, ni me chercher.
— Comment ça, tu viens chercher Maxime ? Questionna ma tante d’un air bourru. Elle n’aurait pas réagi plus brusquement si mon oncle avait eu l’intention de m’enlever.
— Ne t’inquiète pas comme cela, laisse-moi le temps de t’expliquer. J’ai pu avoir des nouvelles de Raymond, il est à Marseille, et de la zone libre où j’ai fait un passage, j’ai pu lui téléphoner. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il souhaiterait voir son fils dont il languit beaucoup.
— Il va pouvoir venir ? Questionna grand-mère.
— Mais non, maman, c’est beaucoup trop dangereux. Aussi c’est moi, avec l’aide de mes réseaux qui va faire passer Maxime jusqu’à Marseille.
Tante et grand-mère crièrent d’une même voix :
— Vous êtes devenus fous, vous voulez exposer cet enfant à un tel risque ? Vous avez évalué les dangers d’un tel voyage ? Vous voulez le faire tuer ? Son père l’avait envoyé ici dès le début de la guerre pour qu’il soit en sécurité et maintenant c’est tout ce que vous trouvez ? Il n’y a pas pire comme idée pour le mettre en danger.
Vous pensez bien que nous avons réfléchi à tout cela, et pesé tous les risques. Ce que nous faisons pour tant de gens, nous pouvons le faire pour Maxime. Son père n’a qu’une hâte, revoir son fils, même que pour quelques jours. Ne vous inquiétez pas, nous vous le rendrons dans quelques semaines et en bonne santé.
— Tu es sûr ? Quand même, passer la ligne de démarcation, puis rejoindre Marseille, un enfant de son âge !
— Mais ma tante, nous avons un réseau bien rôdé et Maxime sera accompagné. Tous les rendez-vous sont pris.
_Tu feras bien attention ?
— Promis ! Demain matin nous prendrons le train pour Paris et après-demain, en route pour Moulins, c’est dans cette ville que mes amis le prendront en charge. Son père a déjà toutes les dates, et il l’attendra à la gare.
Pendant toute cette discussion, je n’avais pas été ni personnellement informé du projet, ni consulté sur les risques de ce voyage. La seule chose qui m’importait, c’était que j’allais revoir mon père.
La soirée se passa en évocation de ce voyage qui semblait bien effrayer ma tante et ma grand-mère. Je finis par craindre toutes ces réticences, me demandant si mon oncle n’allait pas renoncer, compte tenu des obstacles soulevés. Non, rien n’ébranla ses certitudes, comme quoi, tout allait bien se passer. C’était si bien préparé.
Je me posais quand même une question, ce n’était pas possible que je me présente devant mon père, dans ces habits de souillon, parfaits pour la campagne et ses travaux, mais pas pour la grande ville, surtout que papa avait toujours pris soin de ma tenue. Je n’allais pas demander à ma tante qui n’en avait pas les moyens de m’offrir une garde-robe neuve. Mais j’exigeais malgré tout de mettre mes chaussures vernies, j’aurais ainsi déjà meilleure allure.
Le lendemain, c’est le cœur gros, que je quittais ma famille. Me voici à nouveau en route pour de nouvelles aventures. Je ne connaîtrais donc jamais la stabilité et la tranquillité ? Consolation, j’allais revoir papa.
Tonton m’avait procuré une petite valise en carton, c’était plus pratique que le baluchon que m’avait préparé ma chère tante, elle n’était pas plus grande que mon cartable. Je n’ai pas conservé un souvenir impérissable de mon voyage jusqu’à Moulins, juste que tout se passa bien.
Moulins est une petite ville charmante qui se prélasse le long de l’Allier. Cette importante rivière prend tout son temps avant d’aller se diluer dans le fleuve royal, en cette saison son niveau est très bas, et il est très facile de la traverser à gué.
Mon oncle avait l’allure d’un promeneur tranquille. Nous allions de rue en rue, le nez au vent en badaud, je remarquais qu’il était très attentif, surveillant sans cesse si quelqu’un ne nous suivait pas, ou ne nous observait pas. Il m’avait fait promettre de ne parler à personne et si quelqu’un me questionnait, je devais toujours répondre que je ne savais pas.
— Nous avons eu tort de prendre cette petite valise, tout le monde nous remarque. Nous devons nous en défaire.
Dans un coin très à l’écart des regards, il fît un paquet de mes affaires dans une chemise, et jeta la valise dans un buisson. Je me retrouvais comme prévu avec mon baluchon.
Rassuré que personne ne nous eût suivis, il se décida à frapper à la porte d’une petite maison isolée dans une ruelle. Une vieille dame nous ouvrit.
— C’est vous Georges ? Ils n’ont pas pu vous joindre à temps ?
Pourquoi Georges, ce n’était pas le nom de mon oncle. Je suivis ses instructions et ne posais pas de question.
— Pourquoi qu’y a-t-il de changé ? Tout n’est pas en ordre comme prévu ?
_Non, et vous auriez dû être prévenus à temps. Il s’est passé qu’une urgence est apparue. Deux aviateurs anglais et un haut responsable de notre mouvement devaient rejoindre Londres de toute urgence. Le réseau entier avec nos relais s’est mis à leur disposition, ils sont en route depuis hier.
— Mais c’est dramatique pour nous. Cet enfant est mon neveu, il devait rejoindre son père à Marseille dans les meilleurs délais. Je n’ai aucun moyen de le prévenir. Quand seront-ils de retour ?
— Huit jours au moins.
— Ce n’est pas possible, il faut qu’il arrive demain soir au plus tard.
— Si vous pouvez passer la ligne, je peux vous aider, mais c’est bien parce que c’est vous !
— Comment passer la ligne sans mes contacts, c’est impossible.
— Je n’ai pas la solution, à vous de la trouver Georges. Vous savez, la rivière est très basse et il y a beaucoup de gués par ici. Je ne dis pas que c’est sans danger, mais beaucoup le tentent avec succès. Si vous ne pouvez pas attendre huit jours, c’est à vous de voir.
— Comment nous aideriez-vous, une fois en zone libre ?
— Il y a une grange pour accueillir pour la nuit ceux qui passent par ici. La Croix-Rouge les visite et le soir il y a une distribution de soupe chaude. L’homme qui conduit le cheval est des nôtres. C’est un homme robuste à la barbe blanche. On ne peut pas se tromper, il porte aussi un grand béret basque de berger. Vous l’aborderez discrètement et vous lui direz : « la mère Michel m’a dit que le matin, l’eau était bonne “
— C’est tout ?
— Oui ! Il comprendra et viendra plus tard vous parler et vous aider. Maintenant Georges, soyez très prudent, surtout avec le petit.
— Oui, bien sûr. Merci et à bientôt.
Mon oncle m’avait pris par la main, et nous marchions à nouveau au hasard dans les rues de Moulins. L’après-midi s’avançait, il nous fallait trouver une solution. Nous avions atteint l’Allier. Nous étions presque arrivés au pont de fer qui séparait les deux zones. J’observais mon oncle qui depuis un moment suivait les va-et-vient des Allemands de garde sur le pont.
Les deux extrémités de ce pont étaient fermées par des barrières, des guérites permettaient aux soldats de trouver un abri. Par deux, ils arpentaient sans arrêt toute la longueur du pont pendant. Aux extrémités du tablier du pont, se tenaient en vis-à-vis, d’autres soldats qui surveillaient les rives en amont et en aval.
— Cela m’a l’air bien gardé ! As-tu remarqué comme ces gros piliers sont en retrait du tablier ? Si quelqu’un arrive à s’approcher de ces piliers, de là-haut on ne doit pas pouvoir le voir. Qu’en penses-tu ?
— Je ne sais pas tonton.
— Allez viens !
Sur le quai, il y avait un marchand d’articles de pêche. Tonton poussa la porte d’un geste décidé. La clochette au bout de sa lame de ressort, agita son grelot, le vieil homme qui travaillait devant son établi, leva nonchalamment la tête, son regard de myope derrière son pince-nez, nous dévisagea rapidement.
— Je vous demande une minute, je finis cette mouche, car c’est un travail délicat.
— Faites !
— Voilà, je suis à vous, que désirez-vous ?
— Deux cannes à pêche, une pour moi et une pour un enfant.
— Vous avez une préférence de marque, vous voulez le modèle...
— Non, merci, je ne suis pas un connaisseur, je veux deux morceaux de bambou, avec un fil de pêche et un bouchon.
— Vous voulez vraiment pêcher que de la friture ?
— C’est cela, que de la friture. Soyez gentil, servez-nous rapidement.
L’homme s’en alla choisir deux cannes, et dans un rayon deux lignes montées.
— Avec cela, des hameçons quel numéro s’il vous plaît. Et les appâts vers ou asticots ?
— Merci, ni l’un ni l’autre. Combien je vous dois .
Nous avons laissé le vieux monsieur perplexe, il avait enlevé ses lorgnons, qu’il essuyait consciencieusement avec un grand mouchoir à carreau.
Tonton nous conduisit vers le groupe de pêcheurs qui se tenait le plus prêt du premier pilier. C’était un bon coin de pêche, car l’eau qui contournait les piliers faisait des remous propices aux bonnes prises.
Nous dîmes un bonjour aux pêcheurs, qui ne s’inquiétèrent pas de nos accoutrements, ni de notre matériel. En ces temps-là, on ne s’étonnait plus de rien et surtout, nous avions pris l’habitude de ne pas signaler quelqu’un par des manifestations qui auraient pu attirer l’attention sur eux. La règle c’était le silence et le respect de l’anonymat.
Alors quand tonton me dit d’enlever mes chaussures et mes chaussettes, quand il fît de même et retroussa ses pantalons jusqu’aux genoux comme un pêcheur de crevettes, aucun d’eux ne fît attention à nous. Au contraire, ils fixèrent leurs bouchons avec encore plus d’intensité.
Comme cela, tout en continuant notre simulacre de pêche, nous nous approchâmes du premier pilier. Rendu sous le tablier, tonton m’intima par signes de ne plus bouger, je compris qu’à partir de maintenant, nous ne dirions plus un mot.
Impassibles, les pêcheurs continuaient de pêcher. Sur la rive, des passants avaient jeté sur nous quelques regards, vite réprimés et une vie normale avait repris son cours à Moulins. Tous voulaient ignorer maintenant, ce qui se tramait sous leur pont.
Nous écoutions les pas des sentinelles allemandes, leurs bottes cloutées frappant le tablier métallique, nous indiquaient exactement leur situation sur le pont. Nous nous arrêtions en même temps qu’eux et nous repartions ensemble.
Bientôt, nous serions rendus au milieu de la rivière. À cet endroit comme toujours le lit est plus creusé, donc il y a plus d’eau. Moi, j’avais de l’eau jusqu’aux cuisses et le courant était plus fort. Mes chaussures dans la main gauche et de l’autre mon baluchon, les bras écartés au-dessus de l’eau, dans cette situation difficile, je suivais au plus près mon oncle.
J’ignorais que sous mes pieds de grandes pierres plates ou des algues accrochées auraient raison de moi. Elles étaient glissantes comme nos mares gelées en hiver. Je partis d’un seul coup en vol plané, faisant de grands moulinets, comme si j’avais une chance de me raccrocher à quelque chose. Non, rien n’arrêta ma chute, si ce n’est le fond de la rivière. Vainement, j’avais essayé de sauver mon baluchon et mes chaussures vernies. Inutile tentative, tout était au fond de l’eau avec moi.
Je ne pouvais pas crier, mais mon plouff avait averti mon oncle. Il m’attrapa par un bras, me tira hors de l’eau, et le cœur battant nous allâmes nous réfugier sous un pilier. Nous attendîmes longtemps, avant d’être sûrs que les Allemands ne s’étaient aperçus de rien.
Par signes, mon oncle me fit comprendre de mettre mes chaussures. Je mis mes chaussettes trempées dans mon baluchon et je suivis mon oncle qui doucement avançait vers le talus.
— Nous y sommes, plus qu’une grimpette de trois mètres et tu es en zone libre. Tu te souviens bien de la personne à qui tu dois demander de l’aide, tu la reconnaîtras ?
— Bien sûr tonton. Il sert de la soupe le soir et il a un large béret de berger sur la tête.
— Mais pour qu’il te reconnaisse et te fasse confiance, que vas-tu lui dire ?
— Je m’en souviens très bien, c’est comme l’histoire de la mère Michelle qui avait perdu son chat...
— Tu es fou, ce n’est pas ça du tout !
— Mais je sais, c’est pour te taquiner.
— Oui, mais ce n’est pas le moment.
— Je lui dirais, la mère Michelle m’a dit que le matin l’eau était bonne.
— Bravo, je suis fier de toi. Bon, il va falloir faire très vite. Quand tu vas bondir, tu seras à découvert, je ne sais si les gardes vont te voir, je ne pense pas qu’ils s’en prennent à un enfant, aussi je t’en prie, fais très vite pour grimper ce talus.
Mon oncle parlait à voix presque inaudible, tout en me serrant fort contre sa poitrine. S’il ne se décidait pas à me lâcher, je ne l’escaladerais jamais ce talus. Au-dessus de nos têtes, les Allemands d’un pas rythmé continuaient à marteler le tablier du pont.
— Ils s’éloignent, allez fonce !
En deux enjambées, j’étais sur le talus, heureusement il était couvert de hautes herbes auxquelles je pouvais m’accrocher, elles me servaient de rappel et m’aidaient bien dans ma progression.
— Halte... Halte...
Une forte voix, avec un accent que je connaissais bien, criait cet ordre à tue — tête.
J’arrêtais ma montée vers la liberté. Les fréquentant depuis plus de deux ans, je savais qu’ils ne répétaient pas plus de deux fois un tel ordre. Je m’aplatis dans l’herbe en espérant que la terre allait m’absorber et me rendre invisible. Pendant un temps long, même très long, il ne se passa rien. Sauf que j’entendais des voix au-dessus de ma tête. Je tournais lentement mon visage vers le pont. Enfin, je pus voir le soldat qui me tenait en joue. C’était un vieil homme déjà grisonnant, comme son collègue qui se tenait près de lui, avec son arme aux pieds. À cette époque, Hitler avait déjà envoyé toute sa jeunesse se faire tuer sur le front russe. Alors pour ses tâches subalternes, il avait rappelé ces pauvres bougres des réservistes de la guerre de quatorze, dix-huit.
Mes yeux croisèrent le regard du tireur. Peut-être que je lui avais fait penser à son petit fils, il baissa son fusil et de la main me fit signe de grimper.
Le long des quais une foule était pressée, anxieuse elle avait suivi toute cette scène. Au dénouement heureux pour moi, elle laissa exploser sa joie. Les gens criaient, riaient, me faisaient de grands signes. Maintenant c’était au- dessus de ma tête que des gens s’agitaient et m’interpellaient.
— Allez petit dépêche toi, monte vite on va t’aider.
Je regardais cet homme, c’était un soldat français, comme ceux de la débâcle à part que celui-ci était joyeux.
Ces quelques minutes de repos m’avaient permis de récupérer ma respiration et un peu de calme. Je me redressais et repris l’ascension du talus, malgré moi mes membres tremblaient encore et je manquais de force pour franchir ces derniers mètres.
— Allez petit ne tarde pas, car si un officier SS arrive, il vaudra mieux que tu sois là avec nous.
Je rassemblais mes forces et m’accrochant aux herbes je parcourus l’espace qui me séparait de la main tendue par ce militaire.
Une poigne vigoureuse me saisit et m’arracha du talus. De ma main libre, je serrais contre moi mon baluchon. Je n’avais que cela et ne voulais pas le perdre.
La seconde d’après, j’étais sur la berge. Le soldat me prit alors par la taille et me souleva bien au-dessus de sa tête face à cette foule qui applaudissait, tout en poussant des cris de joie.
Mon oncle profitant de tous ces événements bien à l’abri sous le pont avait pu rejoindre la berge sans encombre. Je le voyais parmi ces gens me faire lui aussi des petits signes. Bientôt emporté par le reflux de la foule, il disparut à mes yeux.
À nouveau, j’étais seul.
Un petit groupe s’était formé autour de moi et les questions fusaient.
— Tu es seul ?
— Comment es-tu arrivé jusqu'ici ?
— Qui t’attends ici ? Où vas-tu aller ?
J’avais le tournis, je ne savais plus à qui répondre, et j’étais très fatigué.
— Laissez cet enfant tranquille, il n’est pas en mesure de répondre à toutes vos questions maintenant. Vous rendez-vous compte de l’épreuve qu’il vient de vivre, cet Allemand aurait pu le tuer, il l’avait au bout de son fusil. Je l’emmène à la grange, je m’en occupe, il va se reposer, puis il pourra répondre à nos questions.
C’était une femme aux cheveux déjà grisonnants, portant aisément un bel embonpoint, les manches de son tablier relevées jusqu’aux coudes et les pieds bien plantés dans ses sabots. C’est elle qui venait d’apostropher tous ces gens de la sorte et je me dis qu’une telle femme s’entendrait bien avec tante Augustine.
Avant de partir, je fis un signe de la main aux soldats sur le pont, celui qui avait le fusil et n’avait pas tiré me répondit en souriant. J’ai souvent pensé à cet homme, me demandant si ce geste généreux ne lui avait pas coûté beaucoup d’ennuis.
Effectivement, à l’entrée d’un hameau il y avait une grange dans laquelle se trouvaient déjà des gens. Tous, comme moi semblaient désemparés. Ils avaient le regard inquiet et fuyant, serrant près d’eux une valise ou un paquet auquel ils semblaient beaucoup tenir. Sans doute leurs derniers biens terrestres.
— Qui sont tous ces gens demandais-je.
_Comme toi, des anonymes qui fuient la peur et la misère.
— Mais je n’ai pas peur et je ne fuis pas ! Je veux seulement revoir mon père.
— Tu me raconteras tout cela plus tard, pour l’instant il faut te sécher et te changer, sinon tu vas attraper la crève et ici il n’y a personne pour te soigner. Où sont tes affaires ?
— Dans mon baluchon.
— Mais tout est trempé !
— Bien sûr, j’ai glissé et je suis tombé dans la rivière.
— Mon pauvre petit ! Je vais aller faire sécher tout ce linge, en attendant enroule-toi dans cette couverture que les soldats déposent ici pour les personnes comme toi.
— À quelle heure passe le monsieur qui distribue la soupe ?
— Tu es déjà au courant de ça ? Tu es un petit malin toi !
Cette brave femme, non seulement elle m’avait ramené mes vêtements bien secs, mais aussi une épaisse tranche de pain beurré. Maintenant j’étais vraiment bien, je n’avais plus peur et je voyais mon avenir s’éclaircir. N’étais-je pas en France libre ? Dans mon pays et sans Allemands, je ne risquais plus rien.
Je fus assailli de questions, comme je l’avais promis à mon oncle, j’en éludais la plupart, restant très évasif dans toutes mes réponses. J’avais tort de m’inquiéter, car tous me voulaient du bien.
— Laissez-le tranquille, vous voyez bien qu’il tombe de fatigue. Vous imaginez tout ce qu’il vient de vivre aujourd’hui et ce n’est qu’un enfant. Il va dormir un peu, nous aviserons ce soir ou demain matin.
C’est le bruit fait par les sabots d’un cheval et des roues cerclées sur le chemin, qui me réveilla. Je me levais rapidement, me disant que ce devait être l’homme de la soupe. En effet, un pauvre canasson tirait une drôle de carriole dans laquelle il y avait comme une immense casserole comme je n’en avais jamais vu.
L’homme qui conduisait cet étrange attelage était de taille très moyenne, sa silhouette trapue laissait deviner une force peu commune. Il portait un pantalon de velours noir, une chemise en coton blanche, les manches retroussées jusqu’aux coudes laissaient apparaître des avant-bras musculeux. Une large ceinture de flanelle scindait sa taille. Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était le couvre-chef. Il portait sur la tête légèrement de côté, un large béret noir.
C’était mon homme.
Des hommes, des femmes, sortirent de la grange, et entourèrent la carriole, chacun son tour tous ces gens vinrent recevoir une assiette de soupe et un morceau de pain. Je décidais d’attendre d’être le dernier, cela me permettrait de parler à cet homme discrètement.
— Ben alors petiot tu n’as pas de gamelle ?
— Non !
— Tiens prends celle-là, n’oublie pas de la laisser sur la table dans la grange quand tu n’en auras plus besoin.
— Est-ce que je peux vous parler ?
— Qu’est-ce que tu veux encore ?
— La mère Michelle m’a dit que le matin l’eau était bonne !
Il me fixa d’un air étonné et soupçonneux.
— Tu connais la mère Michelle toi ?
— Sûrement puisque je vous répète ce qu’elle m’a dit.